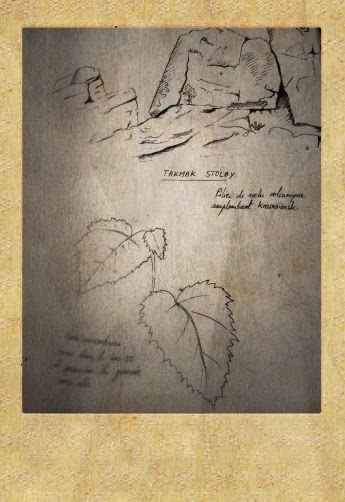 |
| Parc Stolby, Krasnoyarsk © Laurine Roux |
On entre en Sibérie.
Moi je sentais déjà sous mes pieds le tapis d’épines feutré comme un couloir de noblesse, avant la diaspora, couleur de pin, mélèze, épicéa. J’entendais le son clair du vent dans les bouleaux, et que je caresse le blanc des troncs qui frise, sacrée barbe de patriarche. Peut-être qu’on apercevrait l’oiseau de feu, si on s’essoufflait pas trop vite, près de la vieille souche, dans laquelle avait été creusé le pilon de Babaïaga.
Je vous l’ai dit, avant de partir, j’écrivais un roman. Ca romançait dans ma tête. Les Sibériques. L’idée du titre, elle venait de Christophe, cours Belsunce, entre café et café. Vodka, elle, elle aurait préféré Igor. Elle disait que c’était plus juste, sobre et lyrique, ça collait davantage au texte. Je crois qu’elle avait raison. Mais voilà, j’aimais bien Les Sibériques parce que ça allait profond, comme un soc dans une ornière, jusqu’aux Bucoliques. Prétentieusement, j’avais l’impression d’être au champ avec Virgile. C’était classe. Ma petite églogue russe. Alors j’avais marqué Les Sibériques sur la page devant. Rien qu’en me le répétant, j’entendais crépiter les épines d’épicéa sous ma langue, le son clair du vent lessiver les fatigues. Je frissonnais quand la barbe des bouleaux, sacrés patriarches, me chatouillait le flanc.
Bref. Je fantasmais pas mal.
Et maintenant, nous y étions. Krasnoyarsk, porte de la Sibérie. Première étape de notre traversée sibérique. Je sais c’est un néologisme, mais je viens d’en parler, c’est fait exprès, parce qu’on y entend crépiter les épines d’épicéa, enfin, ne m’obligez pas à répéter, vous avez très bien compris.
Krasnoyarsk, vestibule des chimères.
Pourtant, j’aurais dû me méfier. Ma grand-mère me l’a toujours dit, sois littérale, la terre retourne à la terre, te perds pas avec les étourneaux. Elle avait raison. En russe, Krasnoyarsk vient de Krasni Iar qui signifie « ravin rouge ». J’aurais dû me douter. Ici, on est au bord du gouffre, faut pas rigoler, en moins de deux tu te retrouves au fond. On a le sens de la tension tragique. Krasnoyarsk, c’est dur et ça gifle, y a pas de tapis d’épicéa. Le mot, il te taloche dans la bouche, rocailleux et sec, on sent qu’on peut crever, que c’est dégueulasse, on y mourrait salement. Avec un nom pareil, pas de présomption d’innocence.
C’est bête, parce que pas loin, il y avait des villes qui auraient roulé dans la bouche. Komsomolsk-sur-l'Amour. Vous la sentez déjà, la caresse, avant même d’avoir fini le nom. Je comprends pas pourquoi on n’est pas allées à Komsomolsk-sur-l'Amour, mettre du miel dans notre vodka. Là-bas, il n’y aurait pas eu d’usine d’aluminium, de gonds qui grincent, il n’y aurait pas eu de remous, mauvaise odeur de corruption, salut Bykov et fais pas la gueule. A Komsomolsk-sur-l'Amour, on se serait fait des câlins.
Ici, ça grince et c’est pas content. Alors ça boit, autant que coule la Ienisseï. Ça aimerait bien baiser aussi, mais c’est trop bourré. Pourtant, elles chaloupent sur les bords du fleuve, les grandes blondes, hanches à bâbord et à tribord, la poupe au vent, qu’elles vous emmèneraient loin de ce merdier. Mais non. Ça préfère la vodka.
La ville s’étend sur 172 kilomètres, vaste ulcère rongeant les forêts. C’est injuste, je sais, et très péremptoire. Ты нехорошо ведёшь себя. T’es pas gentille. Y a un million de Russes qui vivent là, le bortsch en famille, le baiser du soir déposé sur le front, et que je remonte la couverture parce qu’il fait froid, on ira voir babouchka dimanche, ça vit doux, ça parle chaud, ma chérie, mon amour.
 |
| Krasnoyarsk © Laurine Roux |
S’y engouffrent tous les chagrins, source d’un immense fleuve où se déversent par seaux entier, la suie et le charbon de l’âme. Regardez-les filer le long de la Inenisseï, les ombres grises des décabristes, exilés par le tsar. Elles mélangent leurs pleurs à ceux qui ont péri au Kraslag, livide cortège qui accompagne les décadences postsoviétiques. Il y pleut 129 jours par an, sans compter les foutus 134 jours de renifle, suivis de ceux où ça patauge dans la boue, quand la neige fond.
A Krasnoyarsk, on a rencontré Jeanne, dans le bus 50. Elle se demandait aussi ce qu’elle faisait là.
On a rencontré Sergueï, tellement bourré qu’il ne savait plus ce qu’il faisait nulle part.
Alors, on a pris le téléphérique, pour gagner les mélèzes et leur tapis d’épines d’épicéa. Mais là-haut, au sommet de la montagne, des haut-parleurs dégueulaient une soupe infâme de techno, le long des troncs d’arbre.
Alors on a préféré retourner au fond du ravin rouge, être littérales, la terre qui retourne à la terre et tout ça.
En descendant, j’ai pensé à Agrippa d’Aubigné. Au début, j’ai pas compris pourquoi. Plus tard, dans la nuit, j’ai fait le lien. Les Sibériques, c’était un titre que j’aimais bien. Ça sonnait vert, comme Virgile dans ses Bucoliques. J’avais jamais pensé que ça pouvait sonner rouge, comme les Tragiques d'Aubigné, et boucler la boucle, avec Krasni Iar.
En descendant, j’ai pensé à Agrippa d’Aubigné. Au début, j’ai pas compris pourquoi. Plus tard, dans la nuit, j’ai fait le lien. Les Sibériques, c’était un titre que j’aimais bien. Ça sonnait vert, comme Virgile dans ses Bucoliques. J’avais jamais pensé que ça pouvait sonner rouge, comme les Tragiques d'Aubigné, et boucler la boucle, avec Krasni Iar.
Pour les autres épisodes, c'est ici:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire